maloya : http://www.youtube.com/watch?v=0_ExaijWpRo
Chacune des populations qui composent la Réunion a apporté ses traditions
et sa culture. Le brassage humain qui s'effectue depuis trois cent ans sur
l'île a donné naissance a une culture créole originale issue de coutumes
européennes, africaines, malgaches, indiennes et chinoises.
La musique et les danses

Le Séga provient du quadrille des colons blancs du XVIIIe siècle,
adapté aux rythmes africains. Le Séga, danse créole par excellence, est très
pratiqué à travers toute l'île.. Il trouve son inspiration dans les thèmes
de la vie de tous les jours.
La Maloya, qui était la danse des esclaves, repose sur des percussion
africaines. Sur un rythme lent, les chansons expriment la nostalgie après une
dure journée de labeur. Un meneur de jeu lance une phrase, que les
danseurs reprennent en chœur en battant des mains. Là encore, les thèmes sont
puisés dans le quotidien.
La musique réunionnaise est bien vivante. Sa diversité fait sa richesse.
Séga, maloya, variété, rock, folklore, métis-maloya, sagaï-maloya, etc ;
tous les mélanges sont possibles. Du maloya-moderne, né d'une fusion entre le
jazz-rock et le maloya, aux troupes folkloriques que retracent l'histoire de la
vie réunionnaise à travers la musique, en passant par la variété et le rock,
chacun trouvera son bonheur.

L'architecture créole traditionnelle mérite une mention particulière, car
elle est en danger. L'entretien des grandes demeures, souvent en bois, coûte
cher et les nouvelles constructions en béton sont bâties dans un style
contemporain. Conscients du patrimoine que représente les "grandes
cases" (demeures des riches planteurs) et les "tit'case"
créoles, les Réunionnais ont institué un Conseil départemental
d'architecture destiné à les protéger.
Il resterait environ 3 000
maisons traditionnelles. Les grandes
villas
créoles ne s'offrent que rarement aux regards, profondément enfouies au
cœur de la végétation, cachées au détour de longues allées de palmiers
ou de camélias.
Construites dès le XVIIIe siècle, elles conjuguent un style
néo-classique français à des influences architecturales venant des
comptoirs
des Inde. Typiques de cette architecture, la vérangue (véranda), galerie
construite en avant de la maison, et les lambrequins, véritables
dentelles sculptés
dans le bois ou la tôle, leur confèrent un charme incontestable.
Les fêtes traditionnelles sont pour la plupart d'origine religieuse. Or, la
Réunion voit cohabiter sur son sol plusieurs religions. Il en résulte une
grande diversité et, au total, beaucoup de fêtes.
La marche sur le feu hindoue
La plus spectaculaire des
festivités réunionnaises, la marche sur le feu,
constitue le temps fort de la fête de Pandialé célébrée par la
communauté tamoule soit en janvier, soit en juillet. Durant les dix-sept
jours qui
précèdent la marche, les pénitents rejouent chaque nuit en psalmodiant
l'histoire
de Pandiale qui, dans la mythologie indienne, est née d'un feu
sacrificiel,
grâce aux prières des sages qui obtinrent pour le roi Droupada ce don
des
dieux.

Le pénitent doit s'abstenir de tout contact physique et se
soumettre à
une alimentation végétarienne, afin d'être pur et de garantir
l'efficacité
du rite. Cette préparation est une épreuve visant à tester la foi et le
courage. Le dix-huitième jour, les pénitents préparent eux-mêmes la
fosse,
divisée en deux parties : le"trou d'feu" sur lequel sont étalées
les braises et beaucoup plus petit, le "bassin d'lait" où le
pénitent plonge les pieds après avoir traversé le brasier. Le bûcher est
allumé selon des règles précises. En fin de matinée, les fidèles se
rassemblent autour du char sacré et l'officiant brise une noix de coco
contre
une pierre ; la procession peut commencer. Sur le parcours, les
pénitents
foulent un sol jonché de pétales de fleurs, dans un but purificateur.
Parvenus
au temple, ils attendent, loin du feu, que le prêtre leur annonce que
tout est
prêt.
Le Cavadée

La fête tamoule attirent fidèles et curieux, ces derniers à cause du
caractère spectaculaire de leurs manifestations. Le Cavadée, (cavadi)) une autre
pénitence, se déroule en février-mars ; il se caractérise par des sacrifices
d'animaux et le passage de broches acérées et de crochets dans la peau. Les
nombreux temples hindous s'ornent de couleurs vives. Parmi eux, ceux de
Saint-Denis, Saint-André et La Possession sont sans doute les plus
fréquentés. Le curieux respectera les traditions hindous en se déchaussant
à l'entrée des temples, en ne portant pas sur lui d'objets en cuir (vache sacré) et en ne
fumant pas.
La religion chrétienne
Résultat de l'effort de christianisation des siècles passés et de l'heureux
métissage des différentes populations de l'île, de nombreux Réunionnais
pratiquent parallèlement , deux religions. Par exemple, les hindous ne voient
aucune contradiction à fréquenter , et le temple tamoul et l'église catholique.
Dénoncée par tous les religieux intransigeants, la double religion populaire
est vivace et vécue sans aucun complexe. Moyennant quoi, les estimations
portent à 95 % le nombre de catholiques à la Réunion.
La piété est grande dons le peuple et de nombreuses petites chapelles,
dédiées à la Vierge, ou à un des nombreux saints locaux fleurissent un peu
partout. A côté de la Vierge, Saint-Expédit jouit d'une forte popularité.
La religion musulmane

La pratique de l'Islam est beaucoup plus discrète et fermée, à la fois aux
influences extérieures et à ceux qui ne sont pas musulmans. A condition de
respecter les règles de bonne tenue, il est néanmoins possible de visiter les
mosquées de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le taoïsme et le bouddhisme
La communauté chinoise s'est en grande partie convertie au catholicisme.
Ceci ne l'empêche pas de fréquenter les temples taoïstes de Saint-Denis ou de
Saint-Pierre et, surtout, de continuer à vénérer les ancêtre sur l'autel
familial.
De même, le visiteur remarquera partout des petits Bouddhas devant lesquels
brûle de l'encens.

La magie et les superstitions
En marge des religions, signalons qu'il n'est pas rare que les Réunionnais
aient recours à la magie ou à la sorcellerie pour se tirer d'un mauvais pas.
Que la superstition côtoie la religion ne choque pas plus les habitants de
l'île que la double appartenance religieuse. Les esprits, tantôt bons, tantôt
mauvais, sont partout présents, il suffit de savoir les voir. Guérisseurs et
sorciers, magie blanche et magie noire, "bébêtes" et démons ; l'irrationnel
et une pensée magico-religieuse sont élaborés à l'époque où la plus grande
partie de la population menait une existence misérable et difficile. Ils
restent un vivant témoignage de la culture créole réunionnaise.
Les héros légendaires :
La Buse, écumeur des mers du sud
La Buse, pirate célèbre qui écuma l'océan indien au début du
XVIIIe siècle, aurait caché un fabuleux trésor (estimé à plus de trente milliard
de francs ! ) quelque part à la Réunion. Aujourd'hui encore, certaines
personnes se lancent à la recherche de ce trésor précieusement conservé dans
l'imaginaire des Réunionnais depuis plus de deux cent cinquante ans.

Olivier Le Vasseur naquit à Calais, il commença sa carrière de
flibustier sur l'océan Atlantique. Mais la piraterie y devint très difficile en
ce début
de XVIIIe siècle et, comme de nombreux autres, Olivier Le Vasseur,
désormais surnommé La Buse, se déplaça dans les années 1720 vers l'océan
Indien où de grands navires à voile transportaient encore des richesses
considérables sans escorte sérieuse.
Bourbon et toute les petites îles de
cette région servaient d'escales aux pirates, leur permettant de réparer leurs
navires et leur fournissant des vivres. (Nombre des aventuriers qui se fixèrent
à cette époque sur l'île étaient d'anciens flibustiers et plus d'un
Réunionnais descend qui par une bisaïeule paternelle, qui par un trisaïeul
maternel, de ces pirates des Caraïbes).
En avril 1721, La Buse pilla un navire portugais venant de Goa et qui
mouillait dans la rade de Saint-Denis ; la Vierge du Cap transportait des
"rivières de diamants, des morceaux de barres d'or, des cascades de
pièces d'or". Le butin, raflé après des combats où tous les membres de
l'équipage portugais périrent à l'exception du vice-roi de Goa, était
fabuleux.

Devenu richissime, La Buse s'installa dans la baie d'Antongil, au nord-est de
Madagascar. Espérait-il y finir sa vie tranquillement ? Il avait été
amnistié par le roi six ans plus tôt, mais cette fois la prise était trop
grosse et il avait en outre commis l'erreur fatale de s'attaquer par la suite à
un navire de la Compagnie des Indes qui ravitaillait l'île Bourbon.
Le vaisseau "La méduse", sur ordre du gouverneur Desforges-Boucher qui voulait retrouver le
forban afin de lui faire avouer où il avait caché le trésor, le débusqua,
l'arrêta et le ramena à Saint-Paul en avril 1730, les pieds aux fers à fond
de cale. Jugé le 7 juillet pour crime de piraterie, il fut exécuté le soir
même, emportant son secret avec lui. Avait-il caché le trésor quelque part
dans la falaise littorale entre Saint-Denis et La Possession ? L'or et les
diamants reposent-il ailleurs dans l'île ? Ou dans une autre île ? Une seule
certitude : le trésor nourrit la légende.
La tombe de Olivier Le Vasseur, dit La buse, à Saint-Paul ne peut même pas
indiquer où fut enterré le pirate, car le cimetière où elle se trouve
aujourd'hui n'existait pas en 1730 !

 Boucan Canot, Reunion
Boucan Canot, Reunion
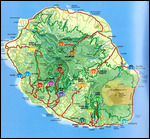

2025-05-23